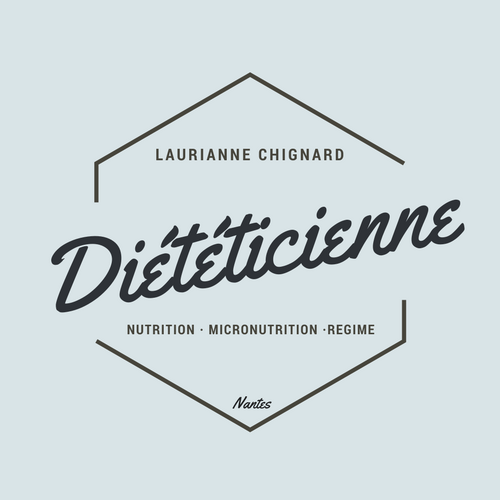Naturopathie ou Micronutrition ?
Laurianne Chignard • 12 juillet 2024
Quelle différence entre micronutrition et nathuropathie ?

Avec le "scandale doctolib" les thérapies alternatives sont sous le feu des projecteurs. Il me parait donc important de rappeler ce qui rapproche et ce qui différencie ces 2 pratiques.
Pour les points communs, il y a cette volonté d'aider le corps à se soigner par lui même en lui apportant des éléments qui lui font défaut, l'usage des plantes, les pratiques naturelles, l'alimentation sont au coeur de ses thérapies. Elle ne se substituent pas à la médecine conventionnelle, elle l'accompagne. Toutes 2 ne sont pas reconnues par l'OMS et aucun cadre légale n'encadre leur pratique en France.
La différence est surtout l'approche : la naturopathie à une approche holistique, la micronutrition sera plutôt scientifique, en se basant sur la chimie de l'organisme et ses conséquences.
De mon coté, je reste avant tout DIETETICIENNE, diplômée depuis 2005 et professionnel de santé reconnu, l'ensemble de mes formations complémentaires ne vise qu'a vous mieux vous accompagner dans l'intérêt de votre santé. Le diététicien étant les seul professionnel de santé reconnu pour prendre en charge l'alimentation (cf article plus bas), les bases sont déjà solides et sécurisées. La formation en micronutrition n'est qu'un prolongement de ce métier. J'exerce comme micronutritionniste, après avoir une formation certifiante sur 2016 et 2017. Je continue d'apprendre au quotidien de part mes échanges avec les professionnels médicaux et paramédicaux de mon réseaux.
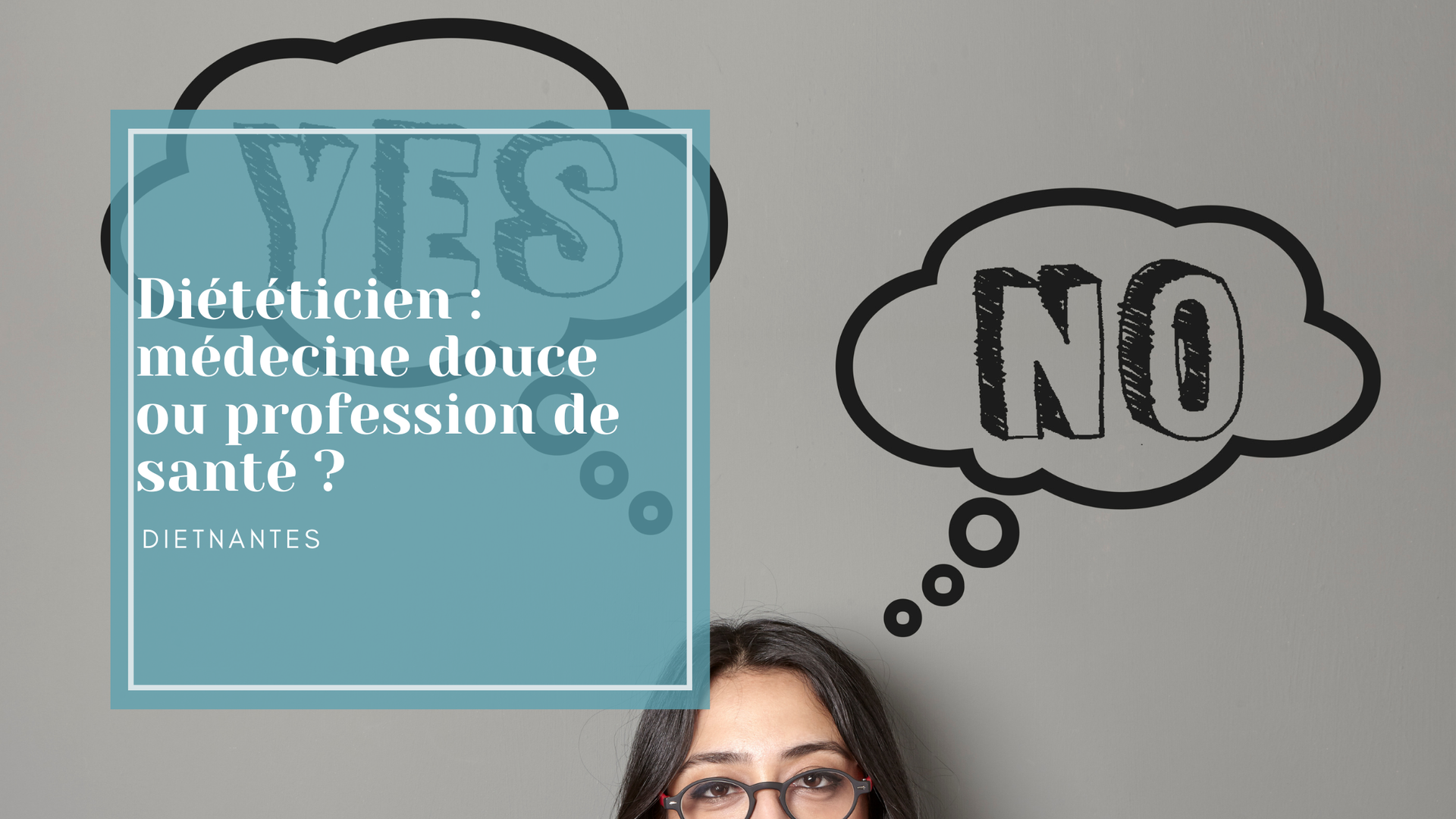
Un projet de loi propose actuellement de retirer des contrats de mutuelle le remboursement des pratiques considérées comme « médecines douces ». Derrière cette mesure, l’intention est de limiter les dérives et de recentrer les financements sur des pratiques validées scientifiquement. Pourtant, de nombreux patients s’inquiètent déjà de ses conséquences collatérales, notamment sur l’accès aux consultations diététiques. Dans les faits, les mutuelles constituent aujourd’hui le principal soutien financier permettant à beaucoup d’entamer un suivi nutritionnel, faute de remboursement par la Sécurité sociale. Cette confusion n’est pas nouvelle. Dans l’esprit collectif, la diététique est encore trop souvent assimilée à une approche de bien-être ou à une pratique alternative, alors que la profession repose sur des bases scientifiques solides et bénéficie d’un cadre légal strict. Les diététiciens sont reconnus comme profession de santé par le Code de la santé publique. L’article L. 4371-1 définit clairement notre rôle : accompagner l’éducation et la rééducation nutritionnelle, participer à la prévention et intervenir sur prescription médicale auprès des patients présentant des troubles du métabolisme ou de l’alimentation. Le titre de diététicien est lui aussi encadré et protégé par l’article L. 4371-2, qui réserve ce nom aux professionnels diplômés. Les articles R. 4371-1 à R. 4371-5 précisent enfin les actes autorisés et les limites d’exercice. Il ne s’agit donc en rien d’une médecine douce. La diététique fait partie intégrante du champ paramédical, aux côtés des infirmiers, des kinésithérapeutes ou des orthophonistes. Ce positionnement juridique contraste pourtant avec la réalité du financement : les consultations diététiques n’entrent pas dans le périmètre de prise en charge de l’Assurance maladie. Cette incohérence crée un paradoxe dont mes patients sont les premiers à pâtir. Ils sollicitent une prise en charge nutritionnelle pour un motif de santé, auprès d’un professionnel de santé, mais doivent, en l’absence de remboursement obligatoire, dépendre du bon vouloir de leur mutuelle. Ce paradoxe est d’autant plus problématique que le surpoids, l’obésité et les maladies métaboliques constituent aujourd’hui des enjeux majeurs de santé publique. Pour y répondre, le système de soins mobilise une multitude de professionnels – sages-femmes, infirmiers, kinésithérapeutes, psychologues, éducateurs sportifs – chacun avec sa spécificité. Pourtant, l’alimentation étant une composante quotidienne, répétée, et déterminante de la santé, elle nécessite l’expertise d’un professionnel dont la formation est entièrement dédiée à la nutrition : le diététicien. Je crois profondément qu’il est temps de clarifier l’organisation des parcours de santé. Il serait cohérent de replacer les diététiciens à leur juste place : celle du référent nutritionnel, formé, diplômé et réglementé. Rendre ces soins accessibles permettrait d’éviter les prises en charge incomplètes ou inadaptées, de réduire le recours à des pratiques non validées et de renforcer la prévention. Nous mangeons tous, chaque jour, plusieurs fois par jour ; la nutrition influence toutes les dimensions de notre santé. L’accès à un accompagnement diététique structuré n’est pas un confort, mais un besoin essentiel.

La question de l’alcool revient très souvent en consultation, en particulier lorsqu’une perte de poids est envisagée. J’entends régulièrement parler de « meilleur alcool », de boisson plus ou moins compatible avec la minceur, ou encore d’un verre qui ne compterait pas vraiment. Il me paraît essentiel de remettre des repères clairs, à la fois sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan métabolique et comportemental. Tous les alcools se valent… en quantité d’alcool pur Un point fondamental à comprendre est la notion de dose bar. Une dose bar correspond à environ 10 g d’alcool pur. C’est exactement la même quantité d’alcool que vous buviez un verre de vin, une bière, un whisky ou un cocktail correctement dosé. Il n’existe donc pas d’alcool « plus léger » ou « moins grave » en soi. Ce qui change d’une boisson à l’autre, c’est la dilution (volume du verre) et la quantité de sucre ajoutée. Un cocktail, par exemple, cumule souvent alcool + sucres rapides, ce qui augmente fortement l’apport calorique et l’impact métabolique.
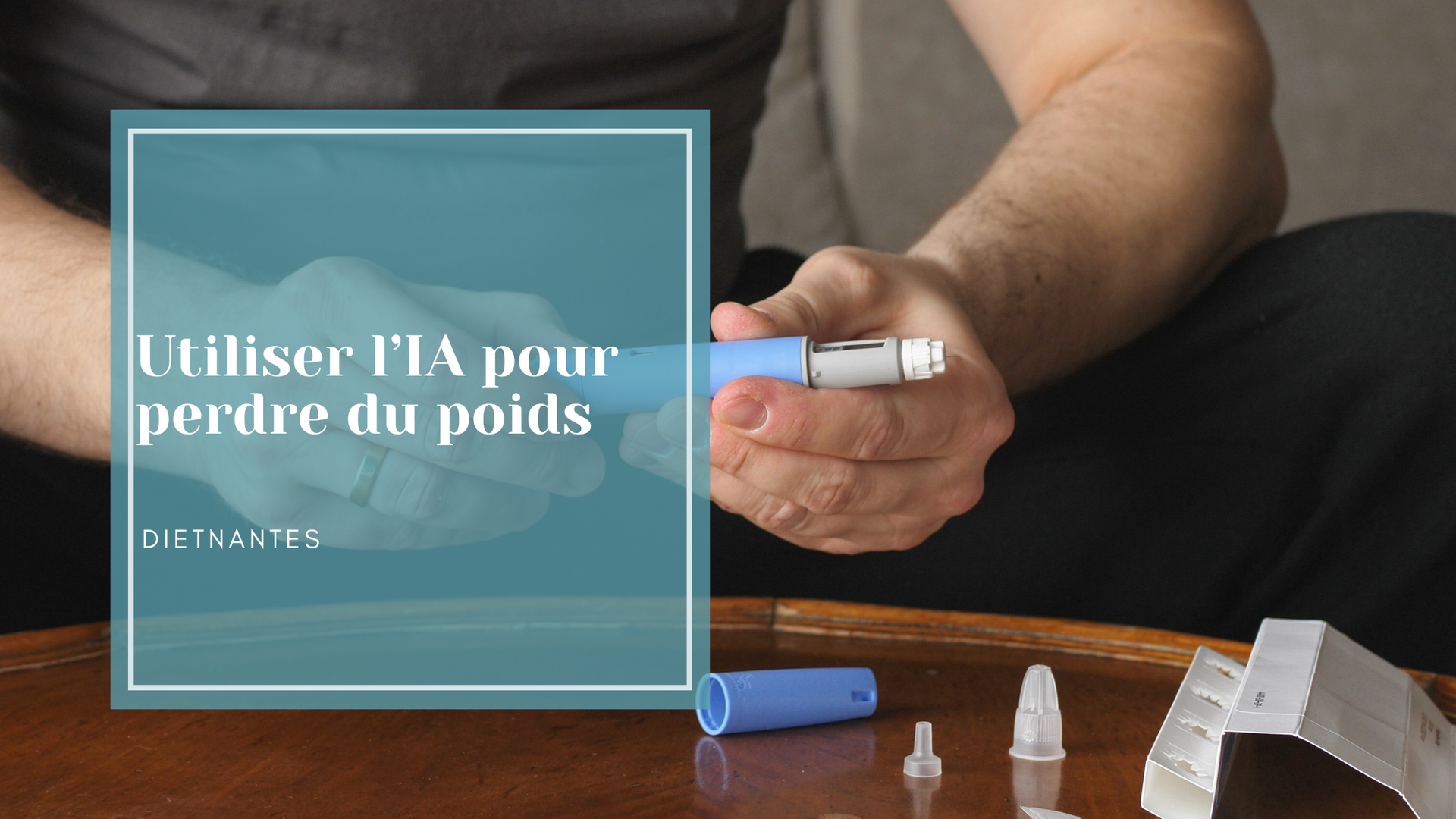
Les agonistes des récepteurs du GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1), tels que le Sémaglutide (Ozempic, Wegovy) et le Liraglutide (Saxenda, Victoza), ainsi que les doubles agonistes GLP-1/GIP (comme le Tirzépatide - Mounjaro), ont révolutionné la prise en charge du diabète de type 2 et de l'obésité. Leur efficacité pour la perte de poids est bien établie. Cependant, se contenter de l'injection sans un accompagnement diététique personnalisé et renforcé est une erreur. La nutrition joue un rôle essentiel pour maximiser les bénéfices, prévenir les risques (notamment la dénutrition) et surtout pérenniser la perte de poids après l'arrêt du traitement. Protéger contre le Risque de Dénutrition : L'Impératif Protéique Les agonistes GLP-1/GIP agissent en ralentissant la vidange gastrique et en augmentant la sensation de satiété, ce qui réduit drastiquement l'apport calorique global. Or, une perte de poids trop rapide et non encadrée expose à un risque majeur : la perte de masse musculaire (fonte maigre), ce qui augmente le risque de dénutrition et ralentit le métabolisme. Il est essentiel d'assurer un apport suffisant, souvent supérieur aux recommandations standard. Les recommandations CSO France sont aujourd'hui de 60g de protéines /j chez les patients obèses, voire plus chez les seniors. On parle bien de protéines et non de viande. Il faut aussi adapter ce chiffre au mode vie de chacun, et ne pas oublier la qualité des protéines. C'est sur ce point qu'une aide diététique peut rapidement devenir essentiel (80% des médecins prescripteurs ne savent aujourd'hui pas à quoi correspondent ces 60g de protéines) Gérer les Effets Secondaires Digestifs Le ralentissement de la vidange gastrique, bien qu'utile pour la satiété, est souvent à l'origine d'effets secondaires digestifs désagréables (nausées, reflux, ballonnements, constipation). Ces troubles sont la seconde cause d'arrêt du traitement (après l'arrêt à cause du cout) Un suivi diététique permet d'adapter l'alimentation pour en minimiser l'impact des effets secondaires Redonner du Plaisir à Manger (Malgré la Perte d'Appétit) Ces traitements réduisent l'impact du "circuit de la récompense" dans le cerveau, diminuant ainsi le plaisir et l'envie de manger. Si cela favorise la perte de poids, cela peut aussi générer un sentiment de perte de plaisir et de frustration. Aussi, à l'arrêt du traitement, les "repas plaisir" reviennent et la reprise de poids est inévitable : il faut des le départ, apprendre à aimer manger peu et sainement Préparer l'Arrêt du Traitement et Prévenir la Reprise de Poids C'est l'étape la plus critique. L'obésité est une maladie chronique, et son traitement doit souvent l'être aussi. Des études montrent qu'après l'arrêt des agonistes GLP-1/GIP, la reprise de poids est un risque très élevé et fréquent, pouvant annuler une grande partie des bénéfices obtenus. Ancrer les Habitudes : Le traitement est une "béquille" métabolique. Le suivi diététique permet de transformer la perte de poids en un changement de mode de vie durable sur les plans nutritionnel et physique pendant le traitement. Plan de Sevrage (Transition) : La reprise de poids est souvent plus rapide si l'arrêt est brutal. Un accompagnement aide à préparer la phase post-traitement en renforçant les nouvelles habitudes et en stabilisant le poids, parfois en association avec un sevrage progressif des doses (si le médecin le permet). Surveillance à Long Terme : Sans les signaux hormonaux du médicament, les mécanismes physiologiques qui favorisent la reprise de poids reviennent. Le suivi diététique et comportemental est le meilleur rempart pour maintenir la perte de poids sur le long terme. Conclusion : L'Équipe GAGNANTE L'utilisation d'agonistes du GLP-1 (Sémaglutide, Liraglutide, Tirzépatide) est un outil thérapeutique puissant, mais son succès durable ne dépend pas uniquement de l'injection. L'encadrement pluridisciplinaire impliquant le médecin, et surtout le diététicien, est la clé. Il assure une perte de poids saine, protège contre la dénutrition, gère les effets secondaires et prépare activement le patient à l'étape cruciale de l'après-traitement. Pour aller plus loin, vous trouverez ici le document d'information patients édité par le CSO : https://www.obesitefrance.fr/image/7315/1505?size=!800,800®ion=full&format=pdf&download=1&crop=centre&realWidth=1240&realHeight=1754&force-inline

L'Indice de Masse Corporelle (IMC) est l'un des outils les plus couramment utilisés pour évaluer la corpulence et les risques pour la santé liés au poids. Simple, rapide et non invasif, il est un indicateur de première intention. Cependant, il est essentiel d'en comprendre l'origine, le mode de calcul, et surtout, les limites importantes qui conduisent à l'utilisation d'indicateurs complémentaires aujourd'hui. D'où vient l'IMC ? L'IMC, ou Body Mass Index (BMI) en anglais, trouve ses racines au XIXe siècle. Il a été développé par le mathématicien et statisticien belge Adolphe Quetelet (1796-1874) dans le cadre de ses travaux sur la distribution des caractéristiques humaines. L'indice était initialement appelé Indice de Quetelet. Il n'a été adopté par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et renommé IMC qu'à la fin du XXe siècle comme indicateur standard pour évaluer l'excès de poids et l'obésité dans les populations adultes. Comment calculer son IMC ? Le calcul de l'IMC est très simple et nécessite seulement votre poids et votre taille. La formule est la suivante : IMC= Taille(m) * Taille(m) /Poids(kg) Exemple : Si vous pesez 70 kg et mesurez 1,75 m : IMC= (1,75 * 1,75) /70 = 3,0625 /70 ≈22,86 kg/m2

La promesse d'une perte de poids simplifiée par l'intelligence artificielle est séduisante. Dans un monde où la surcharge d'information et la complexité des régimes sont omniprésentes, l'IA se présente comme un assistant numérique capable de structurer et d'organiser. Elle excelle à alléger la charge mentale, mais elle est loin d'être un remède universel. Pour réellement réussir, il faut comprendre où se situe la frontière entre l'efficacité logistique de l'algorithme et la finesse de l'analyse humaine. Pour vous aider dans votre démarche je vous mes en italique des exemples de prompts à utiliser L'IA : L'Art de l'Organisation et du Soutien Logistique L'un des plus grands obstacles à un mode de vie plus sain est souvent le manque de constance et la difficulté à organiser son quotidien. C'est là que l'IA devient un allié puissant. Grâce à sa capacité à traiter d'énormes volumes de données, l'IA peut instantanément générer des plans de repas personnalisés, à condition de lui fournir des instructions précises. On ne demande plus simplement : "Fais-moi un régime", mais on élabore un prompt complet : "Je suis un homme de 45 ans, sédentaire, visant 1800 calories. Je suis allergique aux noix et dois préparer des repas familiaux le soir. Peux-tu générer une semaine de repas en maximisant le batch cooking le dimanche ?" Cette précision permet à l'IA d'aller au-delà de la simple calorie pour s'adapter aux contraintes de temps et de préférences. Une fois le menu établi, l'IA s'occupe de la logistique en générant des listes de courses automatisées et catégorisées. En spécifiant même le magasin fréquenté, elle optimise le parcours d'achat, transformant une tâche fastidieuse en un processus rapide et ciblé, permettant d'éviter les achats impulsifs. "À partir du plan de repas ci-dessus, génère la liste de courses. Organise-la par catégorie de magasin (Fruits et légumes, Produits laitiers, Épicerie sèche, Viandes/Poissons). Je fais mes courses chez Leader Price. Indique les quantités nécessaires pour chaque ingrédient." Par ailleurs, ces outils offrent un certain soutien moral mécanique par des rappels constants et une analyse factuelle des progrès. L'IA responsabilise l'utilisateur en lui offrant un miroir objectif de ses données (poids, calories, activité), ce qui est précieux pour maintenir le cap. "Agis comme mon coach de résilience psychologique spécialisé dans la gestion du stress et de la motivation pour la perte de poids. Je me sens actuellement [Décrivez votre émotion actuelle : ex: frustré, démotivé, coupable, anxieux] car [Décrivez la situation récente : ex: je n'ai pas perdu de poids cette semaine malgré mes efforts / j'ai fait un gros écart hier soir / je suis très stressé par mon travail]. Mon objectif est de [Rappelez votre objectif principal : ex: perdre encore 3 kg de manière saine / maintenir mon poids actuel sans obsession]. Adopte une approche empathique, puis réponds en trois étapes distinctes : Recadrage Positif : Rappelle-moi une petite victoire ou un progrès non lié au chiffre de la balance (ex: meilleure qualité de sommeil, plus d'énergie, repas cuisinés). Aide-moi à me concentrer sur les efforts et non uniquement sur le résultat. Analyse du Déclencheur : Pose-moi une ou deux questions de réflexion pour m'aider à identifier la véritable cause de mon émotion (était-ce la faim physique, l'ennui, le stress, une émotion spécifique ?). Action Proactive et Simple : Propose-moi un petit pas concret à faire maintenant pour regagner le contrôle (ex: une technique de respiration, un mini-exercice de pleine conscience, une réorganisation d'un repas futur)" Le Piège du "Trop Healthy" et les Limites de la Redondance Malgré cette efficacité, les propositions de l'IA souffrent souvent d'un manque de réalisme. L'algorithme, en visant la perfection nutritionnelle, peut tomber dans le piège du "trop healthy". Les recettes peuvent exiger des ingrédients coûteux, exotiques, ou des temps de préparation longs, transformant le plan en un idéal de cuisine diététique éloigné de la réalité quotidienne d'une personne active. Ce décalage entre la théorie parfaite et la vie pratique a une conséquence directe : plus le programme est rigide et peu appétissant, plus la tentation de "craquer" et de reprendre ses vieilles habitudes est forte, augmentant considérablement le risque de l'effet yoyo. L'IA optimise les nutriments, mais elle ignore la complexité culturelle et sociale de l'alimentation, un facteur clé de la durabilité d'un régime. De plus, l'IA a tendance à la redondance. Une fois les bases intégrées, les conseils reviennent inlassablement : "buvez de l'eau, mangez des légumes". Cette répétition peut devenir démotivante pour quelqu'un qui stagne ou qui cherche des stratégies avancées pour dépasser un palier. L'Absence Cruciale de l'Analyse et du Soutien Humain Cependant, les limites les plus critiques de l'IA résident dans son incapacité à gérer la complexité humaine. D'abord, la sécurité. En cas de pathologies associées (diabète, problèmes thyroïdiens, ou troubles du comportement alimentaire), un plan généré par une IA généraliste sans supervision professionnelle peut s'avérer dangereux. L'algorithme ne peut pas deviner ou interpréter les subtilités d'un métabolisme ou les interactions médicamenteuses et nutritionnelles. Ensuite, le biais de l'utilisateur. L'IA n'est qu'un miroir de ce qu'on lui donne à voir. L'utilisateur peut oublier, volontairement ou non, de mentionner des facteurs cruciaux comme le stress chronique, un sommeil de mauvaise qualité, ou des habitudes qui lui semblent anodines. Un professionnel humain (diététicien, médecin) est indispensable pour avoir une analyse extérieure, pour poser les questions que l'on ne se pose même pas, et pour interpréter ce "non-dit" qui influence pourtant le poids et le comportement alimentaire. Enfin, il y a la dimension émotionnelle. La perte de poids est souvent un combat contre soi-même. Face à la déception ou à l'épuisement, l'IA ne peut offrir qu'un ajustement algorithmique. Elle ne peut pas offrir l'empathie et l'écoute nécessaires. Dans un contexte où l'on peut déjà se sentir seul face à l'épreuve, l'absence de soutien émotionnel humain ne fait qu'accentuer l'isolement, rendant l'abandon plus probable. Conclusion : L'IA un outil, pas un gourou L'IA est une fantastique assistante de cuisine et de logistique. Elle vous aide à mettre de l'ordre dans le chaos d'une nouvelle routine. Mais n'oubliez jamais : le meilleur régime est celui que vous tenez. Pour qu'un programme soit durable, il doit intégrer vos petits plaisirs, vos contraintes familiales et votre contexte social. Ce sont ces nuances complexes que seul un œil humain extérieur peut vous aider à identifier et à négocier

Impossible de passer à côté si vous vous intéressez à la nutrition : l'alimentation anti-inflammatoire est partout. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias spécialisés, le sujet est omniprésent. Pourtant, loin d'être une simple mode, cette approche repose sur une réalité physiologique : la nécessité d'apaiser le corps face à l'inflammation chronique de bas grade. Il ne s'agit pas de l'inflammation aiguë que l'on observe après une coupure ou une entorse, mais d'un "feu intérieur" subtil et permanent, souvent alimenté par notre mode de vie, le stress et, inévitablement, une alimentation trop riche en produits transformés et en sucres raffinés. Un Dénominateur Commun pour des Pathologies Diverses Ce qui rend cette approche si puissante, c'est que cette inflammation chronique est impliquée dans le développement ou l'aggravation de nombreuses conditions de santé complexes. Elle est désormais reconnue comme un facteur clé dans l'obésité et le diabète de type 2, où les cellules graisseuses contribuent elles-mêmes à un déséquilibre métabolique. Elle joue également un rôle central dans les maladies auto-immunes comme la Thyroïdite d'Hashimoto, ainsi que dans des troubles hormonaux fréquents comme le Syndrome des Ovaires Polykystiques (SOPK) et l'Endométriose. Enfin, les personnes souffrant de syndromes de douleur chronique tels que la Fibromyalgie, le Lipœdème ou l'Arthrite trouvent souvent un soulagement significatif en régulant ce niveau d'inflammation. Comment Manger Soulage les Symptômes ? Adopter une alimentation anti-inflammatoire revient à doter votre corps d'une armée de "pompiers" pour neutraliser les "incendiaires" nutritionnels. Le soulagement des symptômes s'opère par plusieurs mécanismes. L'un des plus importants est l'apport accru en Oméga-3, ces bonnes graisses essentielles qui servent de précurseurs aux molécules capables de mettre fin au processus inflammatoire. De même, un régime riche en antioxydants (que l'on trouve dans les fruits colorés, les légumes et les épices comme le curcuma) protège activement vos cellules contre le stress oxydatif, un moteur de l'inflammation. Enfin, en favorisant une alimentation saine, on soutient la flore intestinale, un point de départ crucial pour apaiser l'inflammation qui, lorsqu'elle est digestive (comme dans le cas du Syndrome du Côlon Irritable), peut affecter l'organisme tout entier. Le Conseil de la Professionnelle : Au-delà de la Base Si les grands principes de l'alimentation anti-inflammatoire – privilégier les produits bruts, les bonnes graisses et les légumes – sont universellement bénéfiques, l'application concrète doit absolument être individualisée. En tant que Diététicienne-Nutritionniste spécialisée en Micronutrition, je vous le confirme : l'inflammation est bien la base commune, mais la stratégie thérapeutique diffère radicalement d'une personne à l'autre. Par exemple, la prise en charge d'un côlon irritable nécessite souvent d'être très vigilant sur certains types de fibres, tandis que celle d'un lipœdème ou d'une arthrite mettra l'accent sur des micronutriments et des pistes hormonales spécifiques. L'alimentation anti-inflammatoire est donc un socle puissant, mais c'est l'ajustement personnalisé qui garantit l'efficacité maximale et durable. Votre Boîte à Outils : Mettre la Théorie en Pratique Pour vous aider à démarrer cette démarche essentielle sans vous submerger d'informations, j'ai conçu un guide pratique qui transforme les principes anti-inflammatoires en plaisir quotidien : L'Alimentation Anti-Inflammatoire : 4 Semaines de Menus et Recettes Dans cet e-book, vous trouverez une feuille de route concrète avec quatre semaines de menus complets et variés, accompagnés de toutes les recettes simples et gourmandes associées, ainsi que votre liste de courses idéale. C'est l'outil parfait pour une mise en pratique immédiate.

Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle semaine ! C'est officiel, nous sommes en décembre. Les journées sont courtes, le froid s'installe, et avouons-le, notre motivation à cuisiner des plats élaborés peut parfois s'envoler. Pourtant, c'est justement pendant cette période que notre corps a le plus besoin de nutriments de qualité pour affronter l'hiver, booster l'immunité, et maintenir notre énergie. En tant que diététicienne, je le sais : l'équilibre ne signifie pas se priver, mais plutôt optimiser son assiette en fonction de ses besoins et de son temps. C'est pourquoi je travaille constamment à vous proposer des solutions concrètes et gourmandes. J'ai sélectionné pour vous 5 recettes de votre application patient qui sont parfaitement adaptées à l'ambiance et aux légumes de saison (courges, choux, légumes racines) pour cette première semaine de décembre. L'idée est simple : vous donner l'impulsion de manger équilibré, sans effort mental !

Chaque année, j’entends la même phrase : « Je viendrai vous voir en janvier, après les fêtes ». Cette idée paraît logique, mais elle vous prive souvent d’un temps précieux pour installer des habitudes utiles, réalistes et durables. Si vous hésitez encore, j’aimerais vous expliquer pourquoi consulter dès maintenant peut réellement transformer votre manière d’aborder la fin d’année, sans restriction, sans régime strict et sans pression inutile. Je ne propose jamais de régime strict ni de protocole culpabilisant. Mon objectif est de vous aider à mieux comprendre votre alimentation, à décoder vos sensations et à mettre en place des habitudes adaptées à votre quotidien. Ce travail peut débuter à n’importe quel moment, et la fin d’année offre souvent un contexte étonnamment propice. Commencer maintenant, c’est aussi l’occasion de prendre du recul sur les stéréotypes qui entourent l’alimentation pendant les fêtes. Beaucoup imaginent qu’entamer un changement d’habitudes en novembre ou en décembre impose de se limiter, voire de se retrouver avec une soupe au chou le soir du réveillon. Je vous rassure : ce n’est ni ce que je propose, ni ce que je ferais moi-même. Même dans une démarche d’équilibre alimentaire, vous avez évidemment le droit de profiter des fêtes comme vous le souhaitez. Le travail que nous faisons ensemble n’a pas vocation à vous priver, mais à vous aider à avancer avec réalisme en intégrant ces moments qu’on retrouve chaque année. C’est également un très bon moment pour interroger vos motivations. Il y aura toujours un événement, une invitation ou une raison de remettre les choses à plus tard. Les fêtes reviennent chaque année, tout comme les repas entre amis, les anniversaires, les sorties improvisées ou les périodes de stress. Ces situations font partie de la vie, et apprendre à les traverser plutôt qu’à les éviter est souvent un point d’appui essentiel. Si chaque obstacle remet vos objectifs en cause, c’est peut-être l’occasion de vous demander ce dont vous avez réellement besoin, si c’est le bon moment pour vous, ou si la méthode que vous avez en tête ne vous convient simplement pas. Mon rôle est justement de vous accompagner dans cette réflexion et dans la construction d’un cadre qui vous correspond. Par ailleurs, consulter avant janvier vous permet de commencer sereinement, sans la pression des « bonnes résolutions ». D’un point de vue pratique, les plannings de fin d’année offrent généralement des créneaux plus rapidement accessibles. À l’inverse, le mois de janvier est l’un des plus demandés, et obtenir un rendez-vous peut s’avérer nettement plus complexe. Enfin, je préfère vous informer en toute transparence : mes tarifs évoluent au 1er janvier. Commencer avant cette date vous permet de bénéficier du tarif actuel tout en initiant un accompagnement qui vous apportera déjà des bénéfices concrets avant même le changement d’année. Si vous souhaitez avancer avec davantage de clarté, retrouver de la stabilité ou simplement vous sentir mieux dans votre quotidien, vous n’avez pas besoin d’attendre un mois « symbolique ». Chaque période de l’année peut être le bon moment pour commencer, dès lors que vous avancez à votre rythme, avec bienveillance et réalisme. Je serai ravie de vous accompagner dès maintenant, pour que les fêtes restent un moment de plaisir et que l’année prochaine démarre dans la continuité, et non dans la rupture.
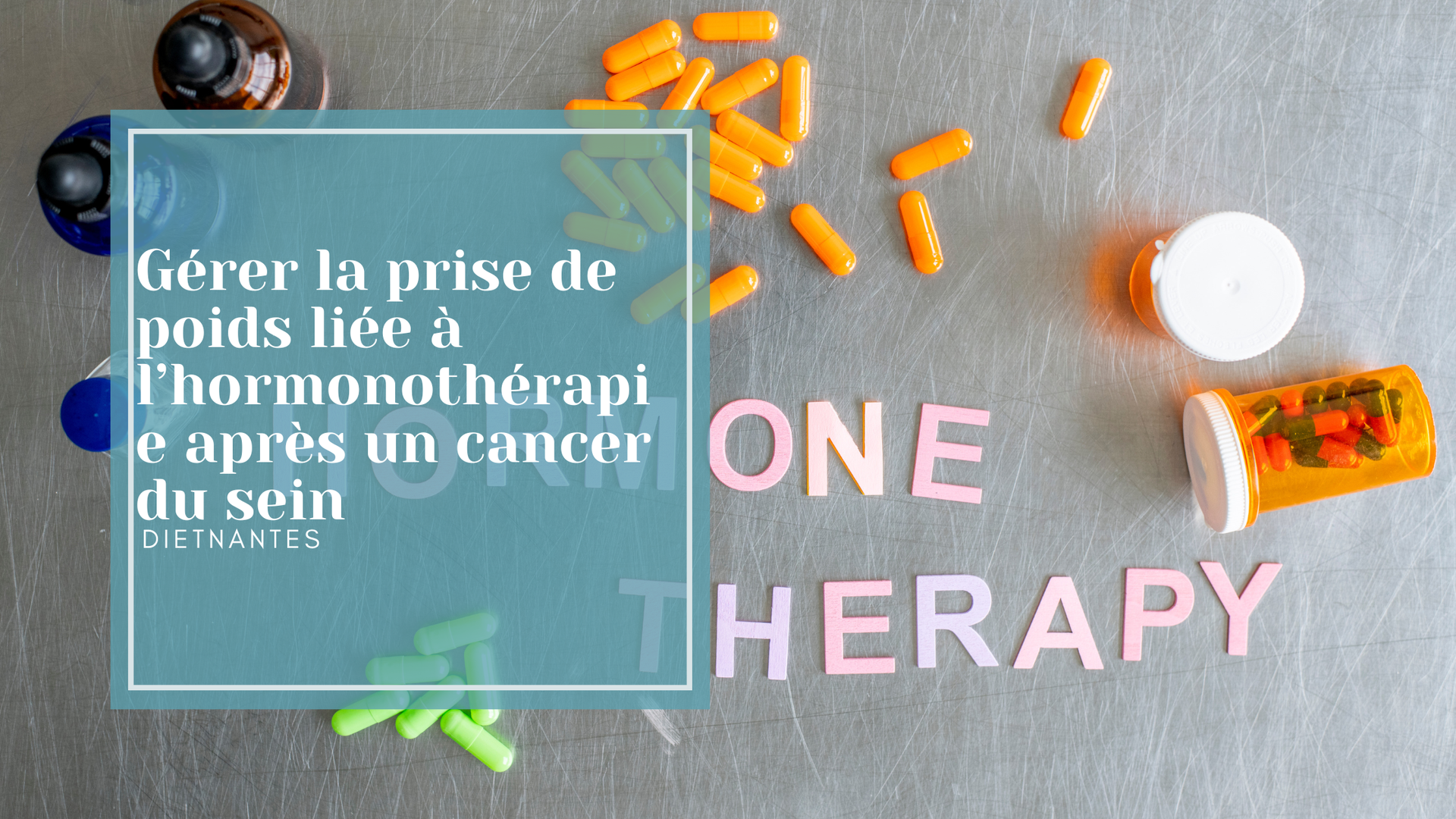
Après un cancer du sein, l’hormonothérapie occupe une place déterminante dans la prévention des récidives. Elle suscite de nombreuses interrogations, notamment lorsqu’une prise de poids ou une modification de la silhouette apparaît au fil des mois, ce qui rend "l'après cancers" encore plus compliqué que prévu, avec ce corps qui change hors de votre contrôle. J’aimerais vous expliquer ce qui se joue, et surtout ce que vous pouvez mettre en place pour retrouver un meilleur confort corporel et préserver votre santé sur le long terme. L’hormonothérapie agit en modulant ou en bloquant l’action des œstrogènes, car ces hormones peuvent stimuler la croissance de certains cancers hormono-dépendants. Qu’il s’agisse d’un anti-aromatase ou du tamoxifène, l’objectif reste le même : réduire au maximum l’environnement hormonal susceptible d’alimenter des cellules résiduelles. Ce traitement constitue donc un pilier incontournable du suivi post-cancer, même s’il n’est pas toujours simple à vivre au quotidien. En parallèle de son efficacité thérapeutique, l’hormonothérapie entraîne des effets secondaires qui peuvent perturber profondément le métabolisme. Une diminution de la masse musculaire, une augmentation de la graisse abdominale, des bouffées de chaleur, une fatigue persistante ou encore une sensibilité accrue aux douleurs articulaires font partie des symptômes les plus fréquents. Ces modifications créent progressivement un contexte propice à la prise de poids, non pas par excès alimentaire, mais bien en raison d’une modification hormonale et métabolique difficile à contrer sans accompagnement adapté. Beaucoup de personnes me confient se sentir en décalage avec leur corps, moins toniques, parfois davantage limitées dans leurs mouvements : "mon corps à pris 40ans depuis la mise en place de ce traitement". C’est précisément ici que la prise en charge diététique prend tout son sens. Mon rôle consiste à vous aider à stabiliser la prise de graisse et à amorcer une perte, tout en protégeant votre masse musculaire et votre capital osseux, qui peuvent être fragilisés par les traitements. Je vous accompagne également pour limiter les douleurs articulaires grâce à une alimentation anti-inflammatoire raisonnée et compatible avec vos traitements. J’aime travailler de façon globale, car je sais qu’un simple ajustement alimentaire ne suffit pas toujours lorsque l’organisme a été bouleversé, car oui, ce n'est pas "facile", les techniques d'amaigrissement simples ne sont pas appropriées et ne donne pas résultats sur le long therme. De plus, ces changements alimentaire doivent pouvoir tenir au moins tout le temps des traitements Votre hygiène de vie dans son ensemble mérite souvent une adaptation progressive. L’alimentation doit être repensée pour soutenir votre métabolisme, optimiser la satiété et maintenir un apport protéique suffisant. Le sommeil joue un rôle essentiel dans la régulation hormonale et la gestion du stress, deux leviers majeurs de la prise de poids post-cancer. L’activité physique, qu’elle soit douce ou structurée, reste l’un des meilleurs moyens de conserver le muscle, d’améliorer la mobilité et de réduire l’inflammation, sans nécessairement parler de “sport” au sens strict. Je privilégie toujours une approche réaliste, adaptée à votre énergie et à vos capacités du moment. Nous pouvons également intégrer la phytothérapie lorsque c’est pertinent, puisqu’elle peut offrir un soutien intéressant sur certains symptômes. Toutefois, n'oubliez pas que les interactions entre plantes et hormonothérapie sont nombreuses et parfois dangereuses. On ne se supplémente jamais seul dans ce contexte. Une évaluation individualisée reste indispensable pour éviter toute interférence avec votre traitement anticancéreux, attention donc aux offre miraculeuses proposées sur les réseaux par des vendeurs pseudo soignants . J’ai à cœur de vous accompagner avec précision et bienveillance dans cette période délicate. Vous pouvez retrouver un équilibre, une silhouette qui vous ressemble de nouveau et un confort corporel réel. Tout cela demande parfois un peu de temps, mais chaque ajustement compte et vous rapproche d’un mieux-être durable.